Accueil > lire, rencontrer > Lectures > Le monde naturel. Entretien avec Étienne Vaunac autour de son (...)
Le monde naturel. Entretien avec Étienne Vaunac autour de son recueil
dimanche 30 janvier 2022, par
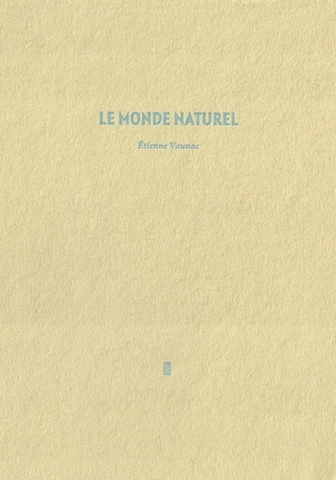
La jeune maison d’édition Le Lierre embrassant la muraille est aussi précise que précieuse dans ses choix éditoriaux. Proche de la revue Arapesh, les éditions Le Lierre propose avec Le monde naturel d’Étienne Vaunac un extraordinaire voyage fait de densité poétique et de singularité d’écriture.
Pour préparer la lecture de cet entretien, il m’a semblé utile, avec l’accord de son auteur, de faire figurer l’image d’un de ses textes. Une première figuration pour entrer dans le tissage du dialogue. (SR)
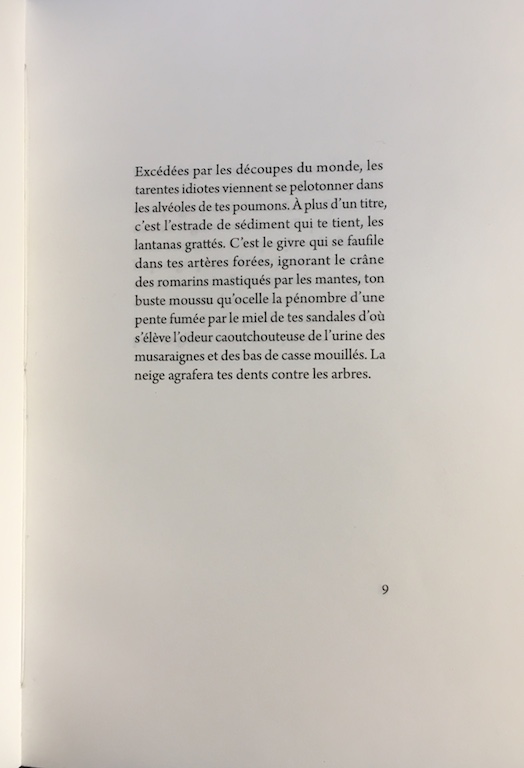
Sébastien Rongier : D’abord la forme même de votre livre Le monde naturel nous fait entrer dans un univers particulièrement cadré et bordé. Chaque texte forme un carré ou un rectangle presque parfait. Avant d’entrer dans les textes, comment s’impose cette forme : ce bloc textuel qui reçoit la prose poétique et l’absence de titre qui introduit cette forme plastique sur la page ?
Étienne Vaunac :
Le Monde naturel se présente comme un ensemble de textes à la forme, effectivement, granitique. Chaque poème est une pierre tombale : on y procède à différents services funéraires (d’êtres naturels ou humains), c’est-à-dire à des célébrations de la vie.
Le choix de donner à lire, et à voir, chaque poème comme un bloc minéral, littéralement lithographique, est tout à fait délibéré et participe pleinement du projet du recueil. J’en profite pour saluer le travail remarquable réalisé par mon patient éditeur, Merlin Jacquet-Makowka, et son associé Constant Candelara. Je dirai que je n’écris pas une poésie stellaire, qui cherche à idéaliser l’univers matériel, mais une poésie stélaire, une poésie de stèles. Je tourne résolument mon regard du côté du bas, de la terre, de ce dont notre regard d’animal debout, projectif et rationnel, ne cesse de se reculer. Étymologiquement, c’est exactement aussi cela une stèle (stáo) : ce qui est debout, dressé. Erectus, le corps humain est la première stèle. C’est en gardant les yeux tournés vers le sol, vers de plus en plus des détails du réel inamical (souvenons-nous de Lacan : le réel c’est contre quoi l’on se cogne) ; c’est en laissant tomber notre regard, en ayant un regard tombal, que le monde s’élargit. Il s’agit par la poésie de se dresser aussi haut sur la pointe des pieds qu’il est possible pour se baisser vers les lieux et les êtres archaïques qui nous justifient. C’est tout le sujet de ces thrènes : la disparition d’un monde et de ses habitants. Notre époque ne le sait que le trop bien. Pour moi, ce monde qui n’en finit pas de mourir prend la forme de la zoologie et de la botanique mais également des occupations humaines du Massif central de mon enfance, et qui sont mon monde, l’horizon chu à partir de quoi l’existence qui est la mienne aujourd’hui fait sens, ou non.
Dans la mesure où l’un des plus hauts sujets de la poésie est la langue, il n’est pas anodin non plus que plusieurs poèmes contiennent des références précises au vocabulaire de la typographie, renvoyant le contenu et le sens du texte à l’exercice de la présentation visuelle rectangulaire du paragraphe. Quand je parle, par exemple, des « découpes du monde », il s’agit tout à la fois des marges d’un lieu géographique, des chutes d’un territoire imaginaire et des opérations de la mise en page et de la fabrication du livre (en dehors de quoi ni les premières ni les secondes n’existent vraiment). En botanique, la stèle désigne la partie centrale de la tige et des racines, celle qui irrigue la plante de sève et de vie.
Sébastien Rongier : Les 20 textes qui composent ce recueil forment une sorte de mariage organique avec la nature. Il s’agit de véritablement faire corps avec la nature, et plus encore avec les insectes qui sont le sujet central du livre. Faire corps est ici à envisager au double sens de l’expression : être au plus proche et créer un corps… trouver une écriture qui rapproche de cette matière organique, ce vivant.
Étienne Vaunac :
Vous avez raison. Insectes et autres arthropodes, mais pas uniquement ; mon bestiaire est copieux – cependant l’essentiel tient bien dans une poésie « de pattes de mouche ». Je n’oublie pas que les premiers insectes représentés dans la tradition naturaliste occidentale – le Codex Cocharelli au XIVe siècle – l’ont été dans les bordures enluminées d’un traité de morale : les insectes naissent du texte et en raturent la surface de signification en ramenant, par le jaillissement des images, les idéalités intelligibles vers la réalité empirique dans laquelle seule nous vivons. Ils replacent d’emblée le visible dans le lisible en une effraction figurative du sens. N’est-ce pas tout l’enjeu de la poésie également que de faire entendre la voix, la phonè du sensible dans la langue, dans le logos des mots ? Il était très important pour moi d’inventer un recours à une langue humaine – on ne peut jamais en sortir, du moins pas dans l’état actuel de la question – qui, tout en s’affichant dans son caractère artificiel, en déborde l’usage courant vers les noms de ce que nous désignons trop souvent fort mal, mots eux-mêmes peu connus ou rares, et faire entendre la perspective de la nature dans le texte. C’est dans ce genre d’états impossibles de la sensation que la poésie trouve sa justification la plus élevée. Quand elle nous fait douter de notre propre corps, c’est-à-dire de notre langue et de nos régimes de stabilité, qu’elle nous ramène à un état non humain de la parole humaine.
Dans la vie de tous les jours, on voit rarement une « sauterelle », et bien souvent ce que nous appelons ainsi n’y correspond pas du tout : on voit une decticelle, une éphippigère, une leptophie, une magicienne dentelée, et ainsi de suite (sans parler parfois des sous-espèces). Je suis profondément attaché aux noms individualisés des insectes, des plantes, des minéraux – de toutes les vies infimes que, devenus citadins, nous ne savons plus regarder. Cela n’a rien, on l’aura compris, d’un effet de préciosité ou de goût pour l’excentricité verbale. Il n’existe que des individus concrets. Une grande part de ce que nous infligeons d’humiliation et d’extinction à notre planète vient précisément de ce que la majorité des êtres humains, qui ont déserté les campagnes, ne savent plus ces baptêmes. Ce qui n’a plus aucun nom exact dans notre langue, qu’elle soit savante, vernaculaire, régionale, peu importe, peut-il exister encore autrement que comme une nuisance, une broutille, au mieux un sujet d’étonnement – c’est-à-dire par rapport à nos craintes ou nos désirs plus ou moins exprimés, mais toujours verbalisables ? La sauterelle n’existe pas. Ce n’est qu’une idée. Pour qui croit dans la sauterelle, que peut bien représenter la disparition d’un concept abstrait ? Quand il n’y a plus de noms pour les êtres singuliers de ce monde, leur sort nous devient indifférent. La poésie, c’est le refus du détachement. Sa tâche est l’attachement au monde. Elle doit faire vibrer l’imprononçable dans le discours.
Sébastien Rongier : Le monde naturel propose également de découvrir un monde en métamorphose, une sorte de transformation constante qui vient comme tension avec l’apparente densité du texte.
Étienne Vaunac
Le monde du Monde naturel est cruel, crispant et émancipateur. C’est que le travail de la poésie ne consiste justement – au moins depuis Baudelaire – qu’à poétiser l’impoétisable. Ce qui est déjà poétisé de telle manière avant l’intervention de ce poème-ci, ou bien de celui-là, ne donne que très peu prise à la poésie (le traitement, au mieux, fera la différence). Que faire de neuf poétiquement avec la violence de la nature – constat confinant au cliché – et qui doit être mise en regard des atrocités que nous lui infligeons : imagine-t-on ce qu’il faut de puissances invisibles de déformation et de destruction pour faire la fleur qui pousse et qui enjolive notre regard ?
Voilà ce qui produit, je crois, cette métamorphose dont vous parlez, qui est d’abord une opération de la langue encore une fois, à savoir une fabrique du monde, et qui passe par des associations d’idées ou des métaphores inattendues, insituables, irreprésentables, comme si le sens était toujours à côté de la littéralité à lire ou des chemins pré-écrits de l’imagination, avant ou après. Cela est accentué, en effet, par l’aspect monolithique des poèmes qui leur confèrent une forme (faussement) marmoréenne et immobile. Par ces juxtapositions déroutantes – dents agrafées sur un tronc d’arbre, « hiver infâme », « épeires potelées », etc. – le texte invente des êtres qui sont à la fois purement linguistiques et intégralement réels. Yves Bonnefoy l’a très bien dit – et je n’ai rien à y ajouter – dans son livre Orlando furioso, guarito : la poésie « casse l’enchaînement de concepts qui voudrait constituer le tout de la phrase dite, et fait donc paraître, au-delà dans les choses de la lecture qu’ils en proposent, une présence pleine qui n’est plus désormais un ensemble de signification mais, si je puis dire, la collaboration de ces choses qui sont des êtres à notre vie ». Il faut s’arrêter sur l’admirable expression « choses de la lecture ». Une telle formule distingue implicitement deux sortes de choses : celles du texte et celles du monde. Un poème n’est pas fait de mots, mais de choses. La poésie, qui ne fait pas comprendre des idées (ce n’est pas la philosophie) mais sentir des présences (et l’écriture du Monde naturel fonctionne aussi sur un registre rythmique, vibratile et musical adressé à l’oreille), crée des choses textuelles. Et ces choses sont des vraies choses. Elles ne sont pas moins véritables que les choses réelles. Elles sont des « êtres à notre vie ». Ou du moins à la vie de celui qui les écrit et qui veut en partager un peu avec des lectrices et des lecteurs.
Sébastien Rongier : Il me semble que ce monde en transformation repose quatre enjeux stylistiques et littéraires sur lesquels je voudrais revenir : la question du point de vue, celle de l’adresse, le choix du vocabulaire et l’enjeu (déterminant) de la métaphore.
Commençons par le point de vue. Chaque texte organise un univers qui se compose depuis un point de vue étrange, un point de vue qui crée l’étrangeté des métamorphoses et rend l’identification narrative ambiguë.
Étienne Vaunac :
L’important pour moi était de parvenir à faire en sorte que notre monde nous apparaisse au premier abord comme un monde extraterrestre. Mais ce monde de science-fiction, comme le disait Deleuze du monde étrange dont parle les philosophes (qu’on pense par exemple à Leibniz avec ses monades et ses plis – quel monde insolite !), est en réalité bel et bien le nôtre. Que se passe-t-il quand je me réveille dans un monde inconnu qui ressemble au mien mais qui en diffère totalement, comme celui des insectes si proche de moi qu’il interfère continuellement dans ma vie parfois la plus intime et pourtant si éloigné puisque régi par les forces de contact et non par la gravitation ? Notre monde est « tout un monde lointain », pour le dire avec Dutilleux. Ce qui est en bas est notre seule là-bas.
Les glissements de points de vue dont vous parlez sont avant tout des glissements d’échelle. C’est-à-dire de nouveau des effets de rampe et de pente. Dès les traités naturalistes de la Renaissance, le grossissement des insectes sur les planches nous invitait à quitter l’homme qui se tient dans notre regard et observer au lieu de l’insecte. Une telle expression est à prendre dans les deux sens du terme : nous devons voir à la fois à la place de l’insecte (du lieu où il se trouve : nous sommes devant l’image imaginairement rapprochés de sa taille) et à la place de l’insecte (en son lieu et place : car c’est toujours nous, des êtres humains, qui sommes les sujets émetteurs de le perception). Les êtres animaux ou végétaux que je convoque dans Le Monde naturel sont des expériences de la vision où le mouvement général des formes naturelles est appréhendé de l’intérieur par un observateur extérieur. La frontière entre l’intérieur et l’extérieur ne passe pas entre l’intérieur et l’extérieur, mais elle passe dans l’intérieur et dans l’extérieur.
Derrida, en reprenant le terme au Verbier de l’homme aux loups des psychanalystes Abraham et Torok, avait appelé cela une crypte – ce qui nous ramène encore une fois aux stèles de tout à l’heure. La crypte obéit à d’autres lois que l’espace qui le contient : « dehors exclu à l’intérieur du dedans » C’est la forteresse, le coffre-fort, ce qui n’est sauf à l’intérieur (le for) que s’il est sauf à (fors) l’intérieur, c’est le trou noir. C’est le texte. La crypte, le cimetière, c’est enfin ce que le français désigne par le mot « aître ». De l’aître à l’être, il n’y a qu’un pas. C’est une autre manière de nommer l’étrangeté à quoi vous faîtes allusion.
Ce qui nous renvoie à la situation du poète lui-même, de celui qui agence les lettres architecturant le monde. Le point de vue sur les métamorphoses – celui du « je » énonciateur, que l’on peut partiellement confondre avec moi mais pas entièrement, pas seulement – est leur premier avatar. Ne conservant pas toujours sa forme humaine, n’étant pas toujours en état de s’exprimer verbalement, ce « je » parle d’emblée par la bouche de la mutation ou de la traduction, de telle sorte que le moment de production de chaque poème ne puisse jamais être transcendé ni résolu par des registres de signification. Tout ceci me fait penser à un passage du théoricien de l’art Jean Louis Schefer, dans Du monde et du mouvement des images : « L’image nous a montré que nous sommes une espèce mutante. Nous sommes, depuis la première image projetée, l’impossibilité réelle des hommes-images ; ils se sont depuis lors multipliés, ils occupent la surface du monde. »
Sébastien Rongier : En prolongement de cette notion de point de vue, la question de l’adresse est souvent centrale dans vos poèmes. La place du « Tu » est aussi déterminante qu’intrigante (cf. p. 19 ou 21). Et plus généralement, les formes pronominales semblent œuvrer vers une désorientation générale (cf. page 13 par exemple).
Étienne Vaunac :
Le tutoiement – si important – s’explique par toute une stratigraphie dont je vais essayer de déplier quelques couches.
Il vient tout d’abord de ma rencontre adolescente avec Du mouvement et de l’immobilité de Douve d’Yves Bonnefoy qui a été pour moi, avec Le Nu perdu de René Char, le texte qui a tout déclenché. « Je te voyais courir sur des terrasses… » J’y ai gagné une envie d’écrire poétiquement. J’ai d’ailleurs initié à ce moment-là un échange avec Bonnefoy qui s’est prolongé en des contours toujours inattendus sur près de vingt-cinq ans, avec de longues interruptions qui correspondaient aussi aux phases de suspension de l’écriture du Monde naturel, dont le passage le plus ancien – évidemment sous une forme très différente – date de 1997. De cela, je ne parlerai pas plus. Je dirai juste que je ne me suis résolu à reprendre ces différents morceaux épars très nombreux, à en éliminer le principal (des pages et des pages) et à envisager de donner une forme définitive au texte pour la publication qu’une fois Bonnefoy disparu.
Le « tu » renvoie à ce qui est le plus personnel dans le recueil – comme on peut le prévoir – mais aussi le plus anonyme. Ce « tu », qui change de sexe selon les poèmes, voire de forme animale et est incessamment soumis à la bascule des incarnations parfois à l’intérieur d’une même phrase, est tour à tour – c’est sa part première, autobiographique – certaines femmes, mon père, tous personnages composés de souvenirs et d’inventions, des figures imaginaires, tel ou tel animal qui organisa mon éducation morale, la lectrice qui me lit. Il est le support de différents affects : amour, exécration, indifférence, réconciliation, joie, etc. – et à ce titre n’est qu’une fonction universelle cumulative, de l’obscurité vers la lumière, de la désolation d’une partie de ma vie vers la promesse de grâce de ma vie actuelle (le lexique théologique insiste de plus en plus au fil des textes) et de mon épouse qui est la seule à m’avoir permis de mener à bien ce projet. Le vécu privé – sur lequel je ne m’étendrai pas – ne trouve sa légitimité en littérature qu’à être déplacé sur un autre plan de l’expérience et l’universel ne se tient nulle part ailleurs qu’à la pointe du singulier. « Tu » est n’importe qui, le premier ou la première venue. Celui dont j’ignore le nom.
Dont le nom est tu. Aussi aménage-t-il un espace de délitement de la langue et de la représentation.
Sébastien Rongier : La question du langage participe également de la densité des textes et de la désorientation du lectorat, peu coutumier avec le langage entomologique. Le tirer vers le poétique, c’est à la fois travailler l’exactitude et ouvrir la langage. Etait-ce en enjeu pour vous ?
Étienne Vaunac :
On revient autrement à la question des noms. Comme on écrit poétiquement avec des choses (au sens tle plus large du mot), le monde n’est pas fait que des choses matérielles et singulières, il est aussi fait de noms propres. La poésie est l’accueil de la présence de chaque chose, chêne, sentier, dalle, orvet…, affleurant à la surface du langage et ne prétend à rien d’autre qu’à la simplicité référentielle des mots. Les noms font partie du monde. Rien n’est complètement s’il ne reçoit pas son nom. Dans le Cycle de Terremer d’Ursula Le Guin, les sorciers peuvent agir sur les choses parce qu’ils possèdent un pouvoir sur les mots et ce pouvoir consiste à connaître le nom véritable de la moindre particule de matière – ce qui fait qu’ils ne peuvent en réalité agir sur rien du tout, car il n’y a pas de composante ultime.
Bonnefoy disait que la poésie, c’est parler de cette pierre, de cet oiseau. Cette pierre n’est pas une pierre en général, non plus que l’oiseau un oiseau en général. Bonnefoy l’a magnifiquement dit à l’occasion de son séjour aux tombeaux de Ravenne, dans L’Improbable, et cela nous ramène encore une fois aux stèles introductives. Dans le poème, les mots généraux – car il n’y a rien d’autre – doivent être fendus et traversés par la vigueur des choses, qui est toujours le poème à venir. Pour la poésie, qui éclaire le monde dans la langue, les choses ne sont jamais de l’autre côté des mots. La densité du poème n’est rien d’autre que celle de la pierre qui l’habite, sa compacité rien d’autre que celle du coléoptère qui y vole.
La poétisation d’un certain langage zoologique – qui ne va pas non plus jusqu’aux vocables de la taxinomie savante – n’est ainsi pour moi que le prolongement de la fonction première du langage, celle du moment retrouvé de l’enfance où nous apprenons notre langue, cette langue où il y a tant encore à découvrir (le monde sera totalement exploré qu’il nous restera encore notre langue à fouiller), dans et par laquelle nous voyons, et où les mots – associés aux images dans les livres éducatifs du premier âge qui sont nos premiers poèmes – sont mis au pied des choses, et les choses prises au pied de la lettre. Malgré certaines apparences, je ne recherche avant tout que la simplicité : mais la simplicité ne se donne pas, la simplicité n’est pas l’immédiateté. La simplicité doit se conquérir continuellement par des voies et des voix toujours nouvelles et déconcertantes. Mon prochain projet (Inanimales) sera le complément du Monde naturel sous la forme, cette fois-ci, d’une série de quatrains libres de structure aphoristique.
Sébastien Rongier : La métaphore est une centrale dans votre écriture. Le choc verbal engendré par des univers qui semblent n’avoir rien en commun serait peut-être le cœur de l’écriture du recueil. La métaphore est l’espace de la métamorphose. Est-ce donc bien le cas ici ? Et comment se structurent ces constructions métaphoriques ?
On pourrait s’appuyer sur le poème page 7 qui fonctionne (comme ailleurs) sur un véritable réseau de métaphores.
Étienne Vaunac :
En effet, la métaphore – plus que la comparaison qui maintient la distinction entre les termes rapprochés et n’évolue que la distance – active des lignes de métamorphoses, d’hybridations et de fondus enchaînés. J’en fais, cela étant, un emploi bien particulier dans ma manière de recourir aux adjectifs. Il y a beaucoup d’adjectifs dans Le Monde naturel. Pour certains, peut-être trop. C’est évidemment tout à fait voulu. Cette abondance – qui pourrait à tort passer pour une affèterie de la langue – obéit à un objectif précis. Les lianes sont « bègues » ; la foudre, « plate » ; les mélanomes, « épistolaires ». C’est que dans mes phrases les adjectifs remplacent les substantifs dans le rôle des mots clés. Leur sens compte en premier, que vient compléter celui des noms – pourtant souvent lus d’abord. C’est une manière encore de réaliser la langue en pliant ses règles internes. Je propose au lecteur d’en accepter la suggestion : ne lire les noms communs que comme des qualificatifs des adjectifs qui – avec les adverbes pour ce qui est des actions verbales – tracent l’essentiel des vecteurs de sens. Il en va de même pour les formules du type les « aboiements de lait », les « sporanges de ta fissure » ou les « grenouilles aux dents cariées ». De proche en proche, tout le texte en est contaminé et invite à un retournement de la grammaire. Cela participe pleinement de l’économie des métamorphoses que nous avons déjà évoquée : le sens n’est plus fixé sur la substance immobile (à quoi renvoient les substantifs) mais sur des modules de qualités, d’intensités et de nuances variables. Le Monde naturel est un livre sans substances. J’ai moins voulu y travailler la coordination et les enchaînements à « entendre » que des effets de juxtapositions, voire d’entassement, d’amalgame, rugueux et solaires, à « écouter », c’est-à-dire à voir (les ruptures de ton et les asyndètes nombreuses vont dans la même direction), puisqu’entendre (et sa polysémie) – comme disait Lyotard – c’est toujours lire.
Sébastien Rongier : Dans ce monde qui se dessine au terme du recueil, on peut également découvrir, ressentir une logique de séparation, une idée de coupure, une violence secrète qui anime cette relation au monde naturel ou dans le monde naturel… une sorte de grondement sourd et de craquement qui parcourt tous les textes.
Étienne Vaunac :
Comme je l’ai rappelé plus haut, le monde du recueil est féroce et sauvage. Inhumain et humain. Que veut dire « sauvage » ? Sauvage est ce qui est adapté à la forêt (silva). On peut aussi y entendre « ce qui va (vagari) seul (solus) ». Ou encore salvus, c’est-à-dire « sauf » – ce qui nous ramène à ce que je disais précédemment sur la crypte. Le sauvage est le solitaire est le sauf. Le poème est le premier lieu de la rupture et de la protection, du divorce et des noces avec le monde naturel. Dans Le Monde naturel, « je », l’être humain se tient sur une ligne de crête qui est aussi une ligne de faille et une ligne d’écriture.
Tout une époque de tremblements parcourt le texte. La nature est sens dessus dessous. La formule est à prendre littéralement. Dans Le Monde naturel, les corps échangent leurs attributs modaux et pénètrent les uns dans les autres. C’est bien le même monde que celui que nous connaissons, mais que l’on ne reconnaît plus tout à fait. Nous recroisons ici la route de la science-fiction ou du fantastique empruntée tout à l’heure – le « tour d’écrou » à la Henry James (la réalité à laquelle on fait subir un quart de tour) –, des tonalités essentielles du recueil. C’et notre monde, mais en même temps il semble toujours décalé par rapport à lui-même ou appréhendé à travers une vue trouble pour laquelle les contours ont perdu leur étanchéité.
Le Monde naturel donne à lire une nature telle qu’elle est vue par un être humain qui se déporte, non pas hors de lui (c’est impossible), mais vers les « partis des animaux » à l’intérieur de son corps et de l’espèce humaine. Il met des images sur la fracture qui nous dé-finit, nous spécifie et nous incise.
Sébastien Rongier : Chaque poème forme donc une écriture des corps insectes, faite d’emboitement et de rapiècements, un univers fait de cadavres dont on ne sait véritablement s’ils sont morts ou servent à d’autres usages ou rites… ceux de l’écriture par exemple.
Étienne Vaunac :
Le cadavre – ce que je tue, elle, vous, ils – habite les stèles. Le mort – pas la mort qui est toujours abstraite et langagière (« Je mourrai dans ta langue » ; telle est la vraie question pour qui parle : quelle sera ma langue au moment de mourir ?) – est l’un des personnages principaux de la tragi-comédie picaresque du Monde naturel. Il est, en effet, trimbalé, malmené dans tous les sens. Le Monde naturel est aussi une scène de théâtre. Et ce cadavre, c’est d’abord l’image elle-même.
J’ai été, dans mes études, profondément marqué par un texte de Maurice Blanchot dans L’Espace littéraire dans lequel il compare l’image au cadavre. Si l’image, visuelle ou textuelle, ne veut pas être un simple décalque de ce qui est déjà visible, c’est-à-dire un diagramme d’incarcération et d’inhumation de la vue, elle doit se dépouiller du visible, se vider et « affirme[r] les choses dans leur disparition ». C’est à ce titre que la dépouille incarne la fonction poétique du dépouillement et d’une écriture saturée. Le cadavre, non plus que la poésie, ne peut pas se laisser enfermer dans la seule logique figurative et mimétique : il ressemble au vivant, mais il est aussi plus lourd, plus imposant ; il n’est que sa propre image. Il y a une étymologie fausse du mot « cadavre » qui m’a toujours séduite : il serait dérivé la formule latine utilisée dans les inscriptions des sépultures des premiers chrétiens, dont il reprendrait les initiales – ca(ro) da(ta) ver(mibus), « chair donnée aux vers ». Il me plaît d’entendre, par les jeux de ma langue, d’autres vers dans ces « vers », qui sont aussi ceux de la poésie.
Sébastien Rongier : Pour finir, ce recueil s’inscrit sur un horizon allant d’une tradition littéraire (de Virgile à Jean-Henri Fabre par exemple), et d’une actualité d’écriture viendrait de la nature writing et irait jusqu’à l’écopoétique qui prend une place nouvelle dans le champs littéraire. Quelles seraient vos proximités, vos distinctions ?
Étienne Vaunac :
Nous en venons aux délicates questions de l’héritage et de l’inscription. Je répondrai à vos deux demandes séparément.
Pour ce qui est de la première, je suis très étonné, selon les retours qui me parviennent, de constater combien les noms diffèrent d’une lecture à une autre. Vous évoquez Virgile (et vous avez raison : Les Géorgiques ont toujours été pour moi un de ces textes indispensables d’une très grande hauteur de vue et de langue), quand d’autres parlent de Lautréamont, de René Char ou de Jacques Dupin. J’ai la faiblesse d’y entrevoir la formulation d’un fil secret reliant malgré tout des poètes aussi divers que ceux cités ci-dessus mais aussi Maurice Scève, John Keats, Walt Whitman ou José-Maria de Hérédia, et qui, avec deux ou trois autres, font partie de mes références avouées. L’un des enjeux du Monde naturel a été de tracer pour moi, et peut-être seulement pour moi, une trajectoire plus satisfaisante dans l’histoire complexe et labyrinthique de la poésie. Évidemment, on peut aussi et surtout lire chaque poème sans ces références, qui peuvent augmenter le plaisir gourmand de la lecture, mais n’y sont en rien indispensables.
Je crois pouvoir dire que j’appartiens, à mon très modeste niveau, à une génération qui est la dernière du siècle des poètes de la présence matérielle qu’auront été Bonnefoy, Dupin ou Char – et qui, plus que cela encore, est sans doute la dernière de notre représentation de la nature telle qu’elle a été façonnée depuis la Révolution industrielle et qui est sans doute arrivée à son terme, quelle que soit la forme proche de ce dénouement. Cette représentation est née avec Keats, John Clare et quelques autres au début du XIXe siècle. Dans quelques années, ce monde aura disparu. Char déjà en 1949 avait écrit « Les Inventeurs » : « Ils sont venus, les forestiers de l’autre versant, les inconnus de nous, les rebelles à nos usages. / […] Oui, l’ouragan allait bientôt venir ; / Mais cela valait-il la peine que l’on en parlât et qu’on dérangeât l’avenir ? / Là où nous sommes, il n’y a pas de crainte urgente. » Avec quelques autres aujourd’hui nous fermons la marche, et mon souci des noms exacts – des insectes ou des plantes – est aussi une manière de dire adieu à ces êtres minuscules qui ont fait mon enfance et de faire résonner encore un peu leurs sonorités poétiquement. Dans l’écho de leurs noms humains parlent la voix de nos victimes non humaines.
Ce qui m’amène à votre second point. Les poèmes du Monde naturel ne sont à mes yeux que le corollaire de l’évidence, non pas de la présence mais de l’effacement de la présence des créatures de l’univers sensible qui nous devient, pour des raisons multiples, indéchiffrable. Ce qui est là, est là : point. Et toute la poésie consiste à ôter les mots de trop qui le recouvre. En poésie, il est toujours question d’en écrire le moins possible. Les poèmes du Monde naturel, plutôt que la densité, ont – je préfère le dire ainsi – l’âpreté de l’élémentaire (y compris syntaxique : l’écriture construit la pensée). Ils sont rêches comme des bastions rocheux, serrés comme des moraines, durs comme le grésil, épais comme la burle : tel est mon pays. Ils ont la certitude de la couleur des guêpes et des ronces, où les guêpes – nous disait déjà Char – ne vont plus. C’est cet aspect monolithique dont nous avons déjà parlé.
Mon héritage est celui de tous les poètes qui ont cherché – tant que faire se peut, c’est-à-dire ne se peut pas – à bousculer le langage humain pour mettre en avant la poésie comme l’activité d’un animal. L’anthropologue Tim Ingold écrit, me semble-t-il, dans Machiavel chez les babouins, qu’il ne faut pas confondre dans l’être humain l’espèce humaine (qui est animale, Homo sapiens) et la condition humaine (morale : l’humanité de la compassion dont il faut faire la « preuve », par exemple). Nous ne poétisons qu’en tant qu’espèce. Nous poétisons moins comme des Terriens que comme des terrestres. Dans le monde tel qu’il nous vient, il faut renverser la célèbre affirmation d’Hölderlin (« Poétiquement habite l’homme sur la terre ») : terrestrement habite l’homme dans la poésie. Hölderlin s’en était d’ailleurs chargé le premier dans les poèmes follement dits « de la folie » dans lesquels il tourne justement le dos à la Grèce éternelle, et à sa nature révolue, immobile et factice, à ses représentations culturelles insistantes, pour célébrer dans la plus remarquable simplicité de la langue le rythme des saisons et la facticité de l’existant, là, sous ses yeux, ouvrant l’un des programmes poétiques majeurs des deux siècles à venir et qui est devenu, pour nos civilisations planétaires, un enjeu critique.
