Accueil > Articles > 2004 > Ailleurs, au bord des routes… (Cambodge, Rwanda, R. Panh et J. (...)
Ailleurs, au bord des routes… (Cambodge, Rwanda, R. Panh et J. Hatzfeld)
vendredi 3 décembre 2021, par
L’aventure continue avec cette belle revue annuelle. Voici le texte tel qu’il a paru, sans ajout ni modification.
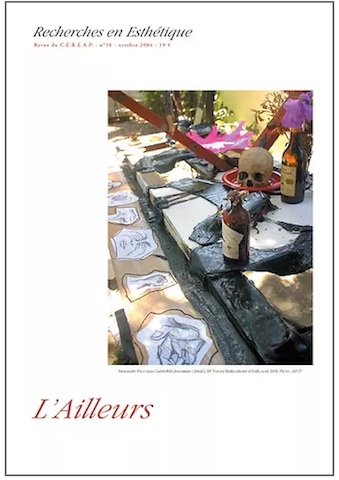
Ailleurs est communément l’endroit où l’on n’est pas. C’est un autre endroit, un endroit autre auquel on attache différentes valeurs, récits et projections. Comme il échappe au quotidien où l’on est, le mot ailleurs désigne un autre part qui échapperait au domaine de la reconnaissance. Le terme est souvent rattaché au champ de l’exotisme. Découvrir l’ailleurs [1], c’est avant tout prendre un rendez vous avec l’autre. L’étymologie latine alius rappelle cette part d’altérité attachée au terme. Suivant les soubresauts du langage et de l’usage, le terme est aujourd’hui un argument de vente pour la consommation aux couleurs de l’exotisme. Les destinations se multiplient en reposant souvent sur des clichés accrocheurs qui nous contentent (exotisme des plages, exotisme des grands espaces, exotisme des paysages et des températures polaires…). Ainsi, en regardant les vitrines des agences de voyages, on multiplie les destinations, les ailleurs, en perdant de vue l’altérité pour ne garder qu’une destination et ses contours. Devant ces magasins, l’exotisme tient lieu d’ailleurs.
A la surface de leurs vitrines, on voit parfois le reflet d’un marchand de journaux. Des images brouillent l’exotisme affiché derrière le verre épais des marchands de voyages. En se retournant, on rencontre d’autres lieux, d’autres espaces qui ne se retrouvent pas dans les catalogues de vacances. Quelques Unes de presse captent les regards et les esprits. On y parle Rwanda, Cambodge, Auschwitz…
L’ailleurs se débarrasse alors de tout exotisme. Il se confronte à l’espace d’une radicalité. Il ouvre l’altérité à une dimension négative et à une forme d’impensé. C’est en effet une altérité totalement autre face à laquelle on se confronte, celle de l’effondrement, celle d’une humanité qui, contre elle-même, renverse l’humanité même de l’homme. Mais peut-on la situer ? La géographie de l’ailleurs ne peut être ici celle d’un non-lieu. Mais la radicalité de cet ailleurs constitué par le génocide implique une distance portée par chacun de nous. Il s’agit donc d’un éloignement qui met en cause l’intimité de chaque conscience et dont on ne peut prendre ses distances. L’ailleurs radical des génocides est au cœur de notre conscience intime et de notre mémoire humaine.
Aussi, face au flux contemporain qui nous place devant des images d’un réel insupportable, cédant la place à d’autres images et à d’autres événements, sans nous laisser le temps d’entendre ce qui se dit et d’analyser ce qui se voit ou ne se voit pas (le flou de l’image contemporaine n’est pas seulement dans la littéralisation des images déformées de la presse écrite ou télévisée), il faut parfois interrompre l’immédiateté et faire retour sur notre temporalité. Pour renverser l’idée d’une réalité versée dans l’ultra-contemporain et dans une théologie d’un temps collé au présent, réduit à son immédiateté, il faut inscrire cette réalité dans une historicité et réinjecter de la pensée dans le temps présent.
Deux œuvres d’aujourd’hui semblent répondre à cette démarche en déployant une interrogation profonde sur la mémoire et sur la confrontation du témoignage à cet ailleurs radical. Il s’agit de deux livres de l’écrivain français Jean Hatzfeld et du dernier film du réalisateur cambodgien Rithy Panh. Jean Hatzfeld poursuit un travail d’écriture particulièrement saisissant sur la mémoire du génocide rwandais au travers de deux livres. Dans le nu de la vie, Récits des marais rwandais publié en 2000 est constitué de témoignages des victimes Tutsies. Une saison de machettes, publié en 2003, est un retour au Rwanda pour se confronter aux paroles des bourreaux Hutus. Rithy Panh poursuit une construction de la mémoire du génocide qui a frappé son pays, le Cambodge. Son dernier film S21, la machine de mort khmère rouge (2002) revient sur les lieux du génocides, retrouve victimes et bourreaux et interrogent cette mémoire qui doit se faire.
Rapprocher ces deux auteurs ne se réduit pas à un simple jeu de l’actualité. Leurs démarches respectives tissent au contraire un dialogue qui renverse cette contemporanéité qui réduit le présent à son flux. En effet, ces deux hommes posent les nouvelles conditions de réception de cet ailleurs qui nous appartient pleinement, le génocide. Des marais de Nyamata aux geôles de l’Angkar, Hatzfeld et Panh poursuivent cette construction de la mémoire et du témoignage. Leurs deux démarches brisent des limites ou des frontières, construisent des formes qui ne répondent pas à un objet connu ou conforme à notre effet d’attente. En résistant aux conditions de formes, ils désignent dans leur matériau d’expression la profondeur de l’expérience d’une altérité. C’est bien ailleurs qu’il s’agit d’aller, mais il s’agit surtout d’un ailleurs impliquant une résistance au conditionnement. C’est pourquoi la question du document se confronte à sa propre condition car ils nous mettent en présence d’une zone qui remet en cause l’humanité même de l’homme. Cet espace du génocide, si loin de nous, est au cœur de notre intimité. C’est ce qu’ils nous apprennent en traversant les pages les plus sombres de notre temps.
Rithy Panh et le geste du bourreau
Le travail du cinéaste Rithy Panh explore inlassablement depuis les années quatre vingt la mémoire cambodgienne en combattant l’oubli programmé du génocide. Dans son dernier film S21, la machine de mort khmère rouge, il revient sur le lieu de la machine destructrice : le camp S21 à Phnom Penh. Il retrouve quelques survivants et quelques bourreaux. Il ne les confronte pas. Ils vont se retrouver en suivant les pas du réalisateur. Une part de l’extrême densité de ce film se tient à la rencontre des victimes et des bourreaux. Elle n’a pas été décidée ou programmée par Panh. C’est une forme du hasard qui décide d’un face à face entre la parole courageuse et terrorisée des victimes et l’apathie et le déni en forme d’indifférence des anciens geôliers.
Vann Nath, peintre et victime survivante et participant au film, se rend sur le site S21 au moment où Panh filmait l’ancien bourreau Roy. La rencontre a lieu, involontaire, tendue, silencieuse jusqu’au moment où Nath emmène Roy voir ce qu’il peint depuis la fin du génocide. Il montre aux anciens bourreaux ses grandes huiles sur toile figuratives et réalistes représentant des scènes de vie et de mort quotidienne dans le camp S21 : groupes de prisonniers attachés au cou et aux mains, les yeux bandés, tirés par un garde adolescent, mais aussi dortoirs bondés de corps alignés et entravés. Images redoutables qui ne sont perdues dans l’oubli. Peintre officiel, victime du système, Nath a survécu grâce à ce talent qu’il retourne depuis contre ses tortionnaires. Ce dont sa peinture témoigne, c’est aussi de ce qu’il n’a pas vu. Lui aussi était entré dans le camp les yeux bandés. Mais en confrontant ses tableaux de tortures et de massacres aux bourreaux eux-mêmes, il valide leur authenticité. Le film explore la tension fragile du survivant confronté à son témoignage, tendue entre intériorité et extériorité, entre une intimité et un ailleurs. Le cinéma vient explorer dans l’image ce travail de l’image. En construisant une longue intimité (le tournage s’est étalé sur trois ans), Panh prend le temps de s’éloigner d’une réalité réduite au présent pour élaborer une autre forme de présent qui permette de faire surgir la vérité et la mémoire. Car « [la] mémoire est, au Cambodge, profondément détruite, émiettée. Au-delà des massacres et des souffrances, les Khmers rouges ont mis en place une machine à effacer la mémoire, une machine totalitaire délirante » précise Rithy Panh [2].
Face à une amnésie grandissante, Rithy Panh tisse une œuvre qui résiste à l’actualité pour construire une mémoire et impliquer une dimension historique en refusant de penser le génocide cambodgien comme une simple folie collective mais au contraire comme une machine et une organisation précise (enjeu que l’on retrouve dans les deux livres d’Hatzfeld).
Pour la période Khmère rouge, on évalue les exécutions à 5000 par semaine. Donc beaucoup d’innocents à tuer. Il fallait une machinerie, une organisation précise. Ce n’était pas une folie collective, tout le monde n’était pas fou. [3]
C’est contre cette terreur froide qui vide la mémoire pour refuse la culpabilité que Panh élabore son cinéma en débordant la stricte extériorisation documentaire pour construire une expérience vive de la mémoire et montrer que l’éloignement radicale du génocide implique pourtant la conscience et l’humanité de tous. A ce titre la séquence la plus marquante de ce film est sans doute celle du geôlier mimant, refaisant les gestes du temps de la terreur qu’il administrait. Cette séquence qui instaure un malaise grandissant permet justement de comprendre l’intériorisation profonde d’une mécanique, celle qui précède précisément tous les génocides. L’ancien tortionnaire est au milieu des salles et des couloirs vides, désormais désert. Il éprouvait un malaise face au langage, aux paroles et aux aveux, soulignant le déni et le camouflage de la mémoire. La victime ne supporte pas d’être victime, le bourreau somatise, travaillé par un déni qui lui assure une conformité face au temps présent. Il refuse son statut de bourreau. C’est son corps même qui le lui restitue. Il semble être à l’aise dans ces lieux. Le comportement de son conditionnement fait retour. Il refait les gestes du temps ordinaire de la terreur. Les portes se mettent à claquer, les gestes à s’emballer. La voix se durcit, les attitudes retrouvent une soudaine vigueur. Les anciennes actions routinières, vieilles d’une vingtaine d’années, reprennent vie : cris, menaces, tortures, coups de bâtons, humiliations. Mais l’on comprend rapidement en suivant cette plongée de l’ancien bourreau au cœur de lui-même qu’il ne mime pas. Il ne joue pas les gestes comme un acteur restituerait une action pour les besoins de la caméra. Rithy Panh n’exprime aucun besoin, n’impose aucune situation. On comprend au contraire que la caméra saisit un inconnu. Le bourreau ne joue pas, ne fait pas ‘comme si’ mais vit littéralement, incarne ce que sa parole dénie. Une brèche explose devant le spectateur. Il a comme une joie de retrouver l’ordinaire de cette jeunesse passée. Elle fait retour dans l’action même du corps tout en mettant en lumière ce qui appartient à la machine idéologique. Pour atteindre un tel degré d’intériorisation, il aura fallu un extrême conditionnement idéologique et psychologique. Le bourreau s’inscrit dans une logique d’autant plus générale qu’elle prend une forme génocidaire. En retrouvant son cadre, le bourreau retrouve les conditions de son encadrement. Ce que son esprit et ses paroles dénient, son corps le retrouve. Les gestes systématisés se répètent sans se mimer ou se singer. Ils sont d’autant plus terrifiant qu’on comprend qu’ils n’appartiennent pas à un dispositif cinématographique mais surgissent de la situation. S’ils se révèlent grâce au cinéma de Rithy Panh, ils ne sont pas construits par lui. La construction cinématographique de Panh produit un vacillement et un renversement de la seule actualité pour déployer un autre temps présent. Ce temps présent formule sa propre altérité en résistant à l’oubli programmé de l’histoire. Son cinéma est là pour saisir et travailler cette résistance et montrer un ailleurs qui subsiste en nous malgré dans sa radicalité. Le lieu du génocide n’est pas seulement l’espace de la prison. Il exprime cette part profonde de notre humanité qui s’abolit dans le massacre. Il en saisit la dimension accablante dans les gestes du bourreau. Il donne une idée de l’insondable dans la peinture et dans les larmes survivantes de Vann Nath. Le cinéma de Panh vient explorer les sédiments de la mémoire, exhumer ce qui n’aurait jamais dû être détruit avant d’être enfoui dans l’oubli. L’exploration des photographies des victimes disparues prend à la fin de son film dédié « à la mémoire », une dimension exemplaire de cette position morale qu’il travaille dans l’image.
Les lointaines collines de Nyamata
Au Rwanda, à la suite des premiers succès militaires d’une rébellion tutsie basée en Ouganda, au début des années quatre-vingt-dix, une fraction majoritaire de la classe politique, de l’armée, de l’intelligentsia hutue, a pensé un plan d’extermination de la population tutsie et de personnalités démocrates hutues. A partir du 7 avril 1994, pendant quatre à dix semaines selon les régions, une partie étonnamment massive de la population hutue a saisi, de gré ou de force, des machettes pour tuer. Les étrangers, les coopérants civils et militaires, les déléguées humanitaires, avaient été envoyés à l’abri. Très rares, et désemparés, étaient les journalistes qui se sont aventurés sur les routes, et pour être peu entendus à leur retour. [4]
Jean Hatzfeld poursuit depuis la parution en 2000 de Dans le nu de la vie un travail sur le génocide des Tutsies du Rwanda en 1994. Il ne s’agit en rien d’inscrire ces lignes dans les macabres concurrences de génocides que l’on peut lire ça et là. Ces courses médiatiques aux vues courtes et aux instrumentalisations redoutables jouant génocides contre génocides, génèrent d’odieux relativismes et alimentent tous les négationnismes. Chaque génocide est unique dans son horreur. Mais les victimes savent entre elles qu’elles portent les signes concordants d’une expérience radicale et unique du chaos.
Jean Hatzfeld ne témoigne pas en journaliste. Il a suivi les événements. Mais il a décidé de ne pas recouvrir les paroles et les témoignages par sa propre expérience. En décidant de contrarier les habitudes du journaliste, Hatzfeld engage une véritable écriture qui inscrit les témoignages dans une mémoire et dans une collectivité, celles de l’Histoire. C’est en ce sens que Géraldine Muhlmann présente les livres d’Hatzfeld comme un exemple particulier pour « traiter les limites du journalisme à partir du journalisme, et non à partir d’une position d’emblée extérieure » [5]. Cette position extérieure est celle d’une écoute et d’une écriture ouverte à l’autre. L’écriture de Dans le nu de la vie manifeste une conscience qui se situe dans une altérité radicale. En construisant un récit qui permette de comprendre et d’accompagner cette confrontation à un autre lieu radical, Jean Hatzfeld élabore une œuvre dense et difficile. Cherchant à faire émerger la vérité des paroles des rescapés, Hatzfeld les accompagne jusqu’à la lisière de leurs propos. Chaque témoignage est précédé d’une description du cadre de vie de celui qui aura la parole. Un univers ordinaire, paisible et contemporain se dessine. Ceci conduit à créer une rupture avec le récit des atrocités vécues par les rescapés. Mais il ne s’agit pas de produire un effet ou d’être dans le procédé. Hatzfeld reconstitue par l’écriture une tension déchirante, insaisissable pour le lecteur, celle de l’abîme du rescapé du génocide.
Les portraits que Jean Hatzfeld dresse avec chaleur et retenue embrassent la vie quotidienne du village. Par petites touches disjointes, il désigne un paysage sans le figer ni le réduire. Il se plonge dans d’infinis détails pour inscrire des moments d’une vie qui continue même lorsque elle est brisée, achevée. C’est la vie de l’après. En glissant quelques fractures, il accompagne le lecteur vers ces paroles qui laissent les blessures béantes.
C’est donc en portant son regard sur les détails les plus quotidiens que Jean Hatzfeld fait surgir la nudité de la vie des rescapés. Parler des vélos-taxis de Nyamata, arrêter sa description sur leurs chromes, puis enchaîner sur l’utilité de ce moyen de transport, c’est amorcer le parcours. C’est s’aventurer dans une grand-rue grouillante de vie et d’activité et découvrir Innocent Rwililiza à qui Hatzfeld cède ensuite la parole [6]. L’espace de la parole est précédé de ce petit voyage dans le quotidien vivant et bruyant pour mieux faire entendre le silence qui règne dans les souvenirs des forêts de Kayumba, c’est-à-dire ce qui appartient précisément à la radicalité de l’Ailleurs.
Je me souviens d’un soir, quelques semaines avant les attaques, je rentrais du boulot avec un collègue et voisin hutu. On parlait de ce qui se négociait au sommet d’Arusha entre les gouvernants et les rebelles, et de nos inquiétudes politiques. A mi-côte, il s’est arrêté, il m’a regardé ; il m’a dit : « Innocent, on va vous exterminer. » Je lui ai rétorqué : « Non, je ne crois pas. Nous allons souffrir une fois de plus, mais nous allons sûrement nous sauver. » Il m’a répété : « Innocent, écoute-moi, je dois te dire que vous allez tous mourir. » Plus tard, j’ai croisé ce collègue dans le quartier, il se baladait dans une camionnette de militaires du camp de Gako, il désignait du doigt les portes de ceux qu’il fallait tuer. Il m’a vu, il a simplement repris son occupation.
(…)
Un jour, je me souviens, j’étais caché derrière une ruine. Des interahamwe sont entrés à l’intérieur et y ont trouvé une famille. J’entendais les coups frappés sur les os, j’entendais à peine des plaintes. Ensuite, ils ont découvert un enfant derrière un puits. C’était une fillette. Ils se sont mis à la couper. Je pouvais tout écouter dans ma cachette. Elle n’a même pas demandé pitié pour essayer de se sauver ; elle a seulement murmuré des petits mots avant de mourir : « Jésus », je crois, ou quelque chose comme ça, puis de simples petits cris. [7]
Dans la grand-rue, on rencontre également par exemple Marie-Louise Kagoyire. Dans le chapitre « Une boutique dans la grand-rue » [8], Hatzfeld évoque Marie-Louise sans dresser un portrait en pied, sans faire un profil ou un jugement systématique. Il travaille par touches formant un portrait oblique mais pas à la manière impressionniste. Son écriture serait sans doute plus proche d’une composition cézannienne. Il opère des passages et brouille les frontières. Pour évoquer Marie-Louise, il écrit par détours en évoquant son environnement (description de son bar et de ses habitués), ou prenant une longue tangeante par l’évolution sociologique et géographique des bars de la grand-rue de Nyamata, il finit par revenir sur elle, achevant ainsi son chapitre avant de lui céder la parole :
La seconde raison du succès de la boutique de Marie-Louise tient bien sûr à la délicatesse de la patronne : son perpétuel sourire, son attachement à ses hôtes, sa descrétion quand elle efface les ardoises des plus fauchés, quand elle renvoie à la maison un buveur somnolent ou désamorce une dispute d’une boutade. Comme le formule joliment Innocent : pas assez de superlatifs n’ont survécu au génocide pour qualifier la gentillesse de Marie-Louise, que personne n’oserait trahir désormais pour un autre cabaret. [9]
C’est à partir de ce sourire que Jean Hatzfeld laisse percevoir au lecteur éprouvé l’atrocité des récits. Il permet à la lecture de mesurer dans cette confrontation à parole une parcelle de l’abîme de le sépare de la compréhension de cette radicalité. C’est dans ce travail de l’écriture que Jean Hatzfeld rencontre le témoignage et souligne la distance qui nous sépare l’effondrement de l’humanité même de l’homme. Là se situe la radicalité d’un ailleurs qui est pourtant au cœur des conscience de chacun d’entre nous.
Lorsqu’en 2003 paraît Une saison de machettes, la violence est la même. La lecture est toujours aussi dure et difficile. Mais cette fois l’auteur s’est confronté aux récits des bourreaux. Ce serait une erreur de voir dans les deux livres d’Hatzfeld un diptyque victime/bourreaux. Non seulement bipartition réduirait le parcours intellectuel et moral d’Hatzfeld mais surtout elle effacerait un travail d’écriture. Hatzfeld a expliqué pourquoi Dans le nu de la vie était concentré sur les seuls rescapés. Car leur parole mérite cet unique intérêt pour combattre l’oubli et l’effacement de la mémoire également évoqué par Rithy Panh. Le témoignage des rescapés combat le silence dans lequel il se tiennent ou sont tenus. Ce sont uniquement des récits qui permettent d’abord de « tenter de comprendre ce génocide » rappelle Hatzfeld [10].
L’écriture de Une saison des machettes n’empreinte pas la même forme que Dans le nu de la vie. Même s’il garde un rythme de bipartition (une introduction de Hatzfeld, les paroles des bourreaux), plusieurs différences importantes permettent de saisir l’enjeu de ce second volume. La plus importante est celle de l’inscription de la parole dans l’écriture. Hatzfeld a réuni les propos recueillis afin de les recouper. La perspective n’est donc pas la même. Il n’y a pas un récit unique mais une marqueterie de propos assemblés selon une autre organisation. C’est là l’autre distinction. Hatzfeld ne découpe pas son volume à partir des personnes mais à partir des thèmes qui permettent une double lecture. Il y a une confrontation inconfortable et douloureuse au mal. Mais il y a également une autre dimension qui émerge de cette architecture, dimension que l’on retrouve chez Rithy Panh : montrer que le génocide n’est pas une folie collective mais la conséquence d’une organisation et d’une machine très précise. Les récits de Dans le nu de la vie soulignaient déjà cet aspect. On pouvait lire ces éléments de l’arrière plan idéologique et organisationnel qui structurent tout génocide. Une saison des machettes plonge le lecteur au cœur de cette mécanique. Comme l’ancien bourreau cambodgien de S21, la bande de copains de Kibungo vit au pénitencier de Rilima dans un déni et une inconscience effrayante.
En tissant au milieu de ces paroles ambivalentes un ensemble de commentaires factuels et historiques, Hatzfeld nous place au plus près de cette mécanique et d’un déni incommensurable. Si l’on découvre d’abord l’organisation des journées de tuerie, on apprend par la suite qu’elles sont quotidiennement suivies de soirées de fêtes.
PANCRACE : Pendant cette saison des tueries, on se levait plus tôt que d’ordinaire, pour manger copieusement la viande ; et on montait sur le terrain de football vers 9 heures ou 10 heures. Les chefs rouspétaient contre les retardataires et on s’en allait en attaques. La règle numéro un, c’était de tuer. La règle numéro deux, il n’y en avait pas. C’était une organisation sans complications. [11]
(…)
ALPHONSE : Le premier soir, en revenant du massacre de l’église, la réception était très bien organisée par les encadreurs. On s’était tous retrouvés sur le terrain de football du départ. (…) On a passé la soirée à les [les vaches] abattre, à chanter et à bavarder des nouveaux jours qui se promettaient. Ce fut la fête la plus emballante. [12]
Avec un peu d’entraînement, tuer devient une activité comme une autre, un travail comme un autre. Cette horreur est décrite avec détachement et professionnalisme, les bourreaux jusqu’à confier que l’activité était moins difficile coutumière que l’agriculture [13] :
ALPHONSE : Au début on coupe avec timidité, puis le temps nous aide à nous habituer. Il y a des collègues qui se sont fait enseigner la manière exacte de frapper : sur le côté du cou ou sur l’arrière de la tête pour activer la fin.
(…)
ELIE : Au fond, un homme c’est comme un animal, tu le tranches sur la tête ou sur le cou, il s’abat de soi. Dans les premiers jours, celui qui avait déjà abattu des poulets, et surtout des chèvres, se trouvait avantagé ; ça se comprend. Par la suite, tout le monde s’est accoutumé à cette nouvelle activité et a rattrapé son retard. [14]
Dans ces extraits, le langage prend une valeur particulière car le déni est général et la banalisation du récit presque naturelle. Jean Hatzfeld l’analyse dans ces pages en rappelant que les tueurs parlent plus aisément de « massacre » ou de « guerre » que de « génocide », préfèrent « personne éprouvée » ou « survivant » à « rescapé » [15]. De même, l’indistinction entre l’être humain coupé [16] et la chèvre ou le poulet subissant le même sort s’explique par la violence faite au langage et par la déshumanisation de la victime dans le langage (les Hutus ne parlait plus au moment du génocide de Tutsies mais de « cancrelats »). C’est un des traits caractéristiques de la machine génocidaire. Les nazis dans les camps de concentrations ne parlaient plus des juifs qu’en terme d’ « unité ». De même, Rithy Panh explique clairement comment la machine génocidaire Khmers rouges a pu se développer à partir de la manipulation du langage :
La violence passe d’abord par le langage. Les Khmers rouge ont commencé par assassiner les mots. (…) Pour manipuler les paysans, il fallait employer un langage très percutant, aussi imagé et concret que le leur. Sur les registres du camp S21, le mot Kamtèch revient souvent. Il ne signifie pas « tuer », mais « détruire », « réduire à la poussière ». Les Khmers rouges ont aussi construit des phrases qui ont la musicalité d’un proverbe, par exemple : (…) « Si on te laisse on ne gagne rien, si on te supprime, on ne perd rien ». Une phrase de ce genre banalise la mort en déshumanisant la victime. Remplacer « tuer », « exécuter » par des mots plus imagés comme « réduire à la poussière » aide le paysan à tuer. C’est ainsi que des adolescents peuvent devenir des meurtriers. [17]
La déshumanisation impliquée par la manipulation du langage inscrit le génocide dans une planification et une organisation générale que Jean Hatzfeld décrit historiquement avec précision [18]. En mettant en parallèle la planification du génocide rwandais avec l’extermination juive par l’Allemagne nazi, Jean Hatzfeld poursuit un véritable travail de la mémoire pour qu’au-delà de nos appels de bonne conscience (le « Plus jamais ça » devenue terriblement hasardeux), ne s’oublie pas l’horreur qui n’est jamais ailleurs :
ALPHONSE : Sauver les nourrissons, ce n’était pas praticable. Ils étaient abattus contre les murs et les arbres, ou ils étaient coupés directement. Mais ils étaient tués plus rapidement, rapport à leur petite taille et parce que leurs souffrances n’étaient d’aucune utilité. On a dit qu’à l’église de Nyamata, on a brûlé des enfants dans l’essence, c’était peut-être vrai, mais c’était le petit nombre dans le brouhaha de premier jour. Par après il n’a pas duré. En tout cas je n’ai plus rien remarqué. Les nourrissons ne pouvaient rien comprendre du pourquoi des souffrances, ça ne valait pas de s’attarder sur eux. [19]
Les œuvres de Rinty Panh et de Jean Hatzfeld ne viennent pas combler le vide laissé par le génocide rwandais et cambodgien. Ils accompagnent la trace de leurs existences. Ils se placent devant un insondable infini et se confrontent à l’horreur radicale avec pour seul impératif une morale de la parole et une nécessité de penser. En confrontant les conditions de la parole et du témoignage au matériau de l’écriture et du film, Rithy Panh et Jean Hatzfeld font face à ce qui ébranle radicalement nos civilisations. Ils tentent de maintenir une tension fragile qui inscrit la tragédie radicale dans notre condition humaine. En cherchant à la comprendre, ils pénètrent dans un indicible pour en faire émerger une parole. Ils n’apportent aucune réponse, ne donnent aucune leçon mais ouvre une béance à notre sens tout en regardant ce qu’il peut rester d’humanité dans ce désastre qui, s’il exprime un ailleurs radical, n’en est pas moins au cœur de notre conscience et de notre intimité. Car c’est dans un double rapport de proximité et d’éloignement que leurs œuvres interrogent l’humain. Les paroles des survivants placent le lecteur devant une tension entre une extériorité et une intériorité. Le témoin a survécu à l’évènement génocidaire qui aurait dû le détruire. Le lecteur, en dehors de ces situations extrêmes, découvre pourtant qu’il est intimement et humainement lié à elles. Ces œuvres qui portent le témoignage de cette tension nous apprennent que l’ailleurs radical du génocide demeure dans une distance profonde. Mais cette distance est inscrite en chacun de nous au nom même de notre humanité qui refuse l’abolition de l’humanité même de l’homme. Elle ouvre une éthique douloureuse et fragile de la dignité de la parole contre la puissance du désastre.
[1] Cette substantivation au singulier dérive de l’expression les ailleurs qui évoquait l’exotisme.
[2] Panh, Rithy, La parole filmée. Pour vaincre la terreur, in Le parti pris du document, Communication numéro 71, octobre 2001, Paris, Seuil, 2001, page 373.
[3] Ibidem, pages 381-382.
[4] Hatzfeld, Jean, Dans le nu de la vie, Récits des marais rwandais, Paris, Seuil, 2000, page 171.
[5] Mulhmann, Géraldine, Du journalisme en démocratie, Paris, Payot, 2004, page 313.
[6] Hatzfeld, Jean Dans le nu de la vie, Op. Cit., pages 91 à 113.
[7] Récit de Innocent Rwililiza, In Hatzfeld, Op. Cit., pages 93 et 102.
[8] Hatzfeld, Ibidem, pages 115 à 118.
[9] Ibidem, page 118.
[10] Ibidem, page 173.
[11] Hatzfeld, Jean, Une saison de machettes, Paris, Seuil, 2003, page 14.
[12] Ibidem, page 113.
[13] « Tuer était moins échinant que cultiver. » Léopold, Ibidem, page 74.
[14] Ibidem, page 44.
[15] Ibidem, pages 187 à 189.
[16] On aura compris que le terme signifie bien massacré à coups de machette.
[17] Panh, Rithy, La parole filmée. Pour vaincre la terreur, in Le parti pris du document, Communication numéro 71, Op. Cit., page 385.
[18] L’obéissance au chef, une idéologie longuement préparée et véhiculée par les classes dirigeantes, militaires, religieuses, intellectuelles, ou médiatiques (les Dix Commandements du Hutu, la radio des Mille Collines…), l’embrigadement des couches populaires préparées, un événement décisif (l’explosion de l’avion du président rwandais Juvénal Habyarimana le 6 avril 1994), la tragique indifférence de la communauté internationnale…
[19] Hatzfeld, Une saison de machettes, Op. Cit., page 159.
